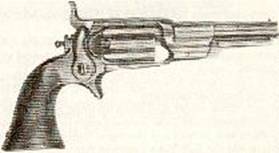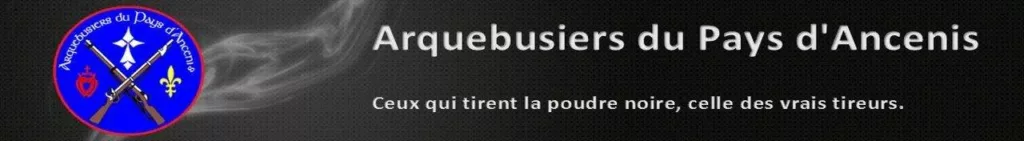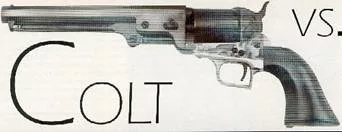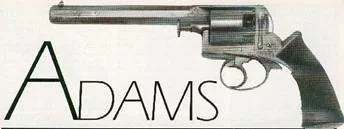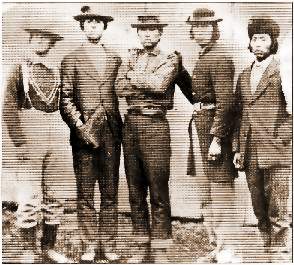Traduction d’un article de W. AUSTERMAN paru dans D.G.W. Blackpowder Annual 1985
(Ce récit débute au début du XIXème. siècle, quand le Texas était encore indépendant et quand le Mexique étendait ses frontières beaucoup plus loin qu’aujourd’hui)
Partie en reconnaissance en cette année 1837 le long de la frontière de la jeune république, une compagnie de Texas Rangers rencontra un cavalier solitaire qui aurait pu servir d’archétype pour une engeance d’hommes qui allaient exporter un commerce horrible de l’autre côté du Rio Grande, et profondément à l’intérieur du Mexique, pour les dix années à venir. Le Capitaine William « Bigfoot » WALLACE sentit un frisson courir le long de sa moelle épinière lorsqu’il se retrouva en face de Jefferson TURNER, un homme qui ne vivait que pour donner la mort à ses ennemis. Tatinnn, Tita-titinnn. Autrefois un colon bien pacifique, ce TURNER avait vu sa femme et ses enfants se faire massacrer au cours d’un raid d’Indiens, et il ne faisait plus à présent que hanter le désert pour assouvir sa revanche. Plus tard, WALLACE se souviendrait de lui comme d’un « type grand et sec, vêtu d’une chemise de chasse et de chausses en peau de chevreuil, avec un bonnet en fourrure de raton laveur sur la tête. Il portait à l’épaule un long et vieux fusil à silex, en fer et de type Kentucky, ainsi qu’un tomahawk et un couteau à scalper passés dans sa ceinture. Ses cheveux étaient emmêlés et pendaient autour de son cou, hirsutes, en de grandes touffes non peignées, et ses yeux sortaient de sa tête, aussi brillants qu’une paire de charbons ardents. » Soixante ans plus tard, le vieil homme de la frontière se rappelait encore ces yeux en frissonnant« J’ai vu toutes sortes d’yeux de fauves, de panthères, de loups, de pumas, de léopards et de lions mexicains, mais je n’en ai jamais vu qui scintillaient, brillaient et dansaient comme ceux qui le faisaient dans cette tête-là. » C’étaient les lanternes de la folie qui y brûlaient, et elles éclairaient le chemin de TURNER dans sa course éperdue après les scalps d’Indiens, c’est-à-dire leur cuir chevelu, découpé et arraché comme trophée. Alors qu’il chevauchait avec les Rangers, il prétendit qu’il venait d’en prendre trois de plus au cours d’une escarmouche avec les sauvages, portant ainsi son palmarès total à quarante-neuf. Quand TURNER se sépara de WALLACE, il se vanta qu’il ne reviendrait pas à la civilisation avant d’en avoir attaché une centaine, étalés et séchés, sur des arceaux.
Jefferson TURNER n’était motivé que par la soif de sang, mais il y en eut d’autres sur la frontière qui trouvèrent qu’ils pouvaient tirer un joli petit profit de ce type d’activité. Vers 1830, les résidents du Nord-Ouest du Mexique abordaient leur troisième siècle de lutte contre l’un des plus implacables ennemis jamais rencontrés par des colons. Les déserts et les collines torrides de la région abritaient les clans guerriers des Indiens Apache. Les Mexicains s’éteint déjà résignés depuis longtemps aux raids d’automne des Kiowa et des Comanche, quand ceux-ci s’élançaient par-dessus le Rio Grande depuis leurs territoires du Llano Estacado au Texas. Mais il s’agissait-là de menaces saisonnières, pas du tout comme les ravages continuels que faisaient les Apache, lesquels ne laissaient que peu de survivants dans leur sillage pour pouvoir pleurer les morts ou ratisser leurs cendres. Des dizaines d’années de guerres sans merci avaient transformé les Mexicains et les Apache en une espèce de vermine aux yeux de l’un et de l’autre. Ce ne fut donc pas surprenant lorsque, en Septembre 1835, l’Etat de Sonora décréta une loi qui offrait une prime de cent Pesos pour le scalp d’un guerrier Apache. L’un des premiers à capitaliser sur cette nouvelle loi fut un ancien chapelier du Kentucky, nommé James JOHNSON. Cet aventurier américain conclut avec le Gouverneur Escalante y ARVIZ un contrat pour mener une expédition officielle de chasse à l’Indien. Se faisant passer pour un commerçant, JOHNSON emmena ses associés vers le nord, dans ce qui est aujourd’hui le Comté d’Hidalgo, au Nouveau Mexique. Il gagna la confiance du chef Indien Juan José COMPA et sa bande d’Apache Mogollon. Après avoir attiré les Indiens dans son camp pour un festin nocturne qu’il leur avait promis, JOHNSON approcha le bout incandescent de son cigare de la lumière d’un petit canon qu’il avait caché sous une pile de selles. Le canon vomit sa charge de morceaux de fers à cheval découpés et de clous dans les Indiens, ce qui découpa les braves, les squaws, et les enfants avec une impartialité féroce. Et boum, et boum, petites patates boum, à nous les cent pesos par tête de patate.
Les blessés et ceux qui n’étaient qu’assommés furent rapidement achevés par balle, pendant que les hommes de JOHNSON se mettaient au travail avec leur couteau. Cette volée de métal fauchant tout le monde venait d’ouvrir les portes d’un trafic qui sera le plus brutal de toute l’histoire de la frontière du Sud-Ouest. Le gars du Kentucky et ses successeurs ont excellé en ce que même les Mexicains ont appelé « une vile industrie », le commerce des scalps humains. Pendant cinquante ans après cette nuit sanglante du 22 Avril 1837, ce sauvage commerce déterminerait les relations entre les Anglos, les Mexicains et les Indiens, du Colorado jusqu’aux limites du grand désert du Chihuahua. Les hommes qui chassaient le cuir chevelu pour de l’argent étaient d’une diversité surprenante quant à leur origine, ne partageant principalement qu’un mépris pour l’humanité de leurs proies. Ils variaient du trafiquant de fourrures, qu’il fût né au Mexique ou qu’il fût auparavant Américain, au déserteur de l’armée, en passant par l’Indien des tribus de Est des Etats-Unis et les émigrants en mal de cash sur le chemin de la Californie. Tous considéraient leurs armes comme les outils de base de leur profession. Ces armes variaient des plus antiques pétoires Espagnoles aux produits les plus modernes de l’industrie armurière de la Nouvelle Angleterre, mais ceux d’entre eux qui eurent le plus de résultats avaient des préférences bien définies en la matière. Le résultat fut un chapitre terrible dans toute l’histoire de l’Amérique.
Le succès de James JOHNSON dans ses moissons de peaux indiennes poussa l’Etat voisin de Chihuahua à décréter sa propre loi sur ce type de commerce, déterminant toute une palette de prix pour les scalps des mâles, des femelles et des petits, en une application cynique de l’économie d’un génocide. L’un des premiers à réclamer ses primes fut un ancien épicier de New York City devenu trafiquant de fourrures, nommé James KIRKER. Aussi appelé « Don Santiago » par les Mexicains, d’origine Irlandaise né en Amérique, cet homme de la frontière et sa compagnie de tueurs constitueront une plaie pour l’Apacherie pendant onze ans, lancés dans une féroce course à la fortune. Bien que KIRKER fût un homme éduqué, et un ancien compagnon de gens aussi connus dans le commerce de la fourrure que William ASHLEY et Jedediah SMITH, ce n’était qu’un mercenaire de la plus basse espèce, dont la soif de sang n’était surpassée que par son avidité de pouvoir. Traînant vers le Mexique au milieu des années 1820, KIRKER avait posé des pièges, il avait cherché de l’or, et fait du commerce avec les Indiens dans cette vaste région entre sa demeure à Janos, Chihuahua et les mines de cuivre du Nouveau Mexique. Avec beaucoup de nerf, et encore plus de chance, il était parvenu à gagner la confiance des Indiens. Ces Indiens allaient avoir de bonnes raisons pour regretter l’amitié qu’ils avaient vouée à ce Yankee pervers. Le massacre de JOHNSON entraînant une révolte indienne, KIRKER réalisa vite que ses chances d’être à nouveau le bienvenu chez eux risquaient de s’être dangereusement amincies, et il décida d’anticiper une attaque éventuelle en frappant les Apache le premier. Rassemblant une bande de durs à cuire qui incluait des trappeurs Français et Anglais, un Noir, deux Hawaïens et plusieurs braves guerriers Delaware et Shawnee, KIRKER lança un raid sur un village Indien, tôt le matin au printemps de 1837, et rapporta dans ses fontes cinquante cinq scalps de guerriers, en plus de la haine de ses anciens amis. Ainsi, lorsque le Chihuahua ratifia sa propre loi sur la chasse à l’Indien, KIRKER avait l’expérience et la réputation nécessaire pour rallier d’autres salopards à sa compagnie. En Avril 1839, il avait déjà obtenu de l’Etat la promesse d’une prime totale de cent mille Pesos pour financer sa guerre contre les Apache. En dépit d’un politique Mexicaine capricieuse et des paiements très intermittents pour ses services, KIRKER harcelait les tribus de Janos à Santa Fe, les traquant jusque dans leurs repaires les plus reculés, et leur engageant une poursuite implacable après chacune de leurs déprédations. En Septembre 1839, KIRKER surprit une bande à Rancho de Taos, au Nouveau Mexique, et en abattit quarante en l’espace de quelques heures à peine. Il répéta cet exploit en Février 1840, en déferlant sur un camp au Sud-Est de Chihuahua et en enlevant quinze scalps de la tête des morts, alors que quarante prisonniers étaient emmenés vers le marché aux esclaves local.
Pendant que KIRKER semait la terreur parmi les Apache et dans leurs rancherias, une caravane de chariots de marchandises et appartenant au marchand américain Albert SPEYER, cheminait péniblement vers le Sud près de Santa Fe, au printemps de 1841. Elle emportait avec elle une recrue potentielle pour KIRKER en la personne du jeune James HOBBS. Ce vaurien de vingt-quatre ans, originaire du Missouri, avait déjà survécu à quatre ans de captivité parmi les Comanches, et il s’y connaissait en combats contre les Indiens.
HOBBS joignit la caravane à Santa Fe, en direction du Sud le long du Rio Grande, vers El Paso et Chihuahua. Il reçut son baptême de chasseur de scalps pendant le voyage. Une caravane de 75 chariots pleins à craquer de marchandise de traite, plus 750 mules, ne pouvaient qu’attirer des pillards Indiens, et lorsqu’elle s’arrêta pour camper du côté Nord de l’aride Jornada del Muerto juste au-dessus d’El Paso, ils firent fuir tous les animaux excepté quelques douzaines. HOBBS partit à cheval à leur poursuite avec quelques hommes et attaqua les Indiens huit jours plus tard, au campement et pendant qu’ils dormaient. Neuf Apache tombèrent sous les balles des Blancs, et le reste s’échappa dans les buissons. Les compagnons Indiens de HOBBS s’empressèrent de peler la toison des braves morts. De retour vers la caravane avec le bétail récupéré, il obtint la promesse de SPEYER qu’ils recevraient une prime en arrivant à Chihuahua. C’est là que HOBBS réalisa qu’il y avait de l’argent à faire dans la lutte contre les Indiens, et veilla à récupérer d’autres trophées pendant que la caravane campait à nouveau à la sortie de la Jornada en arrivant vers Dona Ana, Nouveau Mexique, sur la rive Est du Rio Grande. Alors qu’il montait la garde cette nuit-là, HOBBS devina un mouvement dans l’ombre, et il aperçut un Indien s’approcher subrepticement du troupeau de mules. Le Missourien portait un fusil de chasse dont les deux tubes étaient chargés d’une bonne dose de « pilules de galène ». Il attendit calmement jusqu’à ce que le brave fût à quelques yards de lui, et « balança quinze bonnes chevrotines dans le creux de son dos, qui le tuèrent instantanément ». HOBBS avait gardé prudemment la charge du deuxième canon pour le compagnon du rôdeur, mais personne n’apparut. C’est un SPEYER enchanté qui lui dit en plaisantant qu’il « devrait demander une augmentation de la prime pour des scalps d’Indiens comme celui-là, et celui-ci vaudrait bien cent-cinquante Dollars. C’était le plus grand Apache que j’aie jamais vu, mesurant six pieds et quatre pouces. ». Alors que les marchands venaient de quitter El Paso, HOBBS en arriva à prendre goût à ce nouveau métier de scalpeur. Il admirait l’habileté que déployait le chef Shawnee SPYBUCK ( traduction, non pas Luke SKYWALKER, mais plutôt « Jeune Espion » ), un vieux compagnon de KIRKER dans la chasse au cheveu. Au cours d’une bataille, cet éclaireur lutta tout seul contre vingt Apache et en fit tomber trois de leur selle avec son fusil, avant que le reste ne battît en retraite. Il revint à la caravane avec leurs scalps qui pendaient au bout d’un bâton, pour les montrer à SPEYER. L’équipe passa l’automne 1841 dans la ville de Chihuahua, pendant que les marchands vendaient leur bétail et se préparaient pour le voyage du retour. James KIRKER apparut en ville et commença à recruter pour sa compagnie. Très vite, SPYBUCK rejoignit son ancien employeur et notre jeune et fougueux HOBBS décida de s’enrôler lui aussi. Pas moins de soixante-dix Shawnees et presque une centaine d’Anglos rejoignirent les chasseurs de scalps pendant que « Don Santiago » se préparait pour une grande expédition. Les Apache le devancèrent. Au début de 1842, ils attaquèrent une caravane au Nord de la ville et tuèrent tout l’équipage, sauf un homme. Le survivant parvint au camp de KIRKER pour apporter la nouvelle, et les hommes de ce dernier se mirent immédiatement en selle pour donner la chasse. Après une chevauchée de trois jours, ils arrivèrent au campement des pillards et trouvèrent les braves, ivres-morts d’avoir bu l’alcool qu’ils avaient volé dans les chariots. Les scalpeurs encerclèrent le camp et attaquèrent silencieusement au couteau et à la hachette. Seuls quelques coups de feu furent tirés, pendant que les guerriers complètement saouls mouraient dans leurs couvertures. Quand ce fut fini, quarante-trois jeunes forts étaient étendus parmi les cendres de leur campement. « Les Shawnees les scalpèrent tous immédiatement », se rappela HOBBS plus tard « et SPYBUCK se chargea d’entretenir les trophées macabres, en les enduisant de sel pour les conserver jusqu’à ce que nous retrouvions le gouverneur et qu’il nous donne l’argent de la prime. » C’est pas moi, c’est l’autre, dit-il, mais on voit que rien n’a changé chez les sauvages. Aujourd’hui, on a les génocides africains entre les Schmutzig et les Toutous. Sauf que ceux-là ne se scalpent pas, ils se balancent du haut des ponts ou se découpent entre eux à la machette. KIRKER apprit qu’un autre gros campement d’Apache se trouvait à quelques jours de voyage et proposa de les attaquer eux-aussi. La compagnie se dirigea donc allègrement vers le Nord en direction des sierras, sous le Rio Grande, laissant ses dernières victimes aux loups et aux coyotes. HOBBS dit plus tard que « chaque homme était armé d’un fusil et d’une paire de six-coups, et nous étions tous confiants dans ce qui allait se passer » Si cette histoire se déroule vraiment en 1842, je ne sais pas de quels six-coups il veut parler. Parce que l’arme de poing tirant six coups la plus connue dans cette partie du globe n’était pas encore sortie, que ce soit le Colt 1847 ou le 1851, et que le Paterson, qui n’était d’ailleurs pas tellement fiable, n’en tirait que cinq. Les gens avaient plus souvent des poivrières, et le silex était encore courant. Notre HOBBS était donc aussi menteur que salaud.
La chance du capitaine des scalps tint bon et, en donnant l’assaut sur les bords du Lac Guzman au petit matin, ses hommes détruisirent le village et ramassèrent cent trente neuf nouvelles peaux pour le trésorier payeur de monsieur le gouverneur. La carrière macabre de KIRKER continua florissante pendant plusieurs années encore, alors qu’il chassait l’Apache à travers les étendues sauvages du Chihuahua. En 1845, il revint d’une campagne en rapportant dix-huit captifs et cent quatre vingt deux scalps. Le mois de Mars 1846 le vit sur la frontière Nord-Ouest du Sonora, où il ratissa les villages des chefs Jose CHATO et MATURAN. Le 07 Juillet de cette année-là, ses hommes défirent le chef REYES près de Galena, prétendant rapporter son scalp et cent quarante huit autres après une boucherie sans merci. Les scalps préparés furent pendus sur la façade de la grande cathédrale de Chihuahua pour célébrer ce triomphe. Amen. La déclaration de guerre contre les Etats Unis, et la lenteur du gouvernement local à lui payer les primes qu’il lui devait, poussèrent KIRKER à déserter ses patrons. En Décembre 1846, il quitta le pays en fuyant, avec à ses trousses une prime de dix mille Dollars fixée par les autorités pour quiconque le ramènerait. En guise de représailles, KIRKER chevaucha vers le Nord en direction d’El Paso et rejoignit les volontaires Missouriens du Colonel Alexander DONIPHAN alors qu’ils se préparaient à envahir la province de Chihuahua. A la fin de la guerre, il bricolait par-ci par-là, tantôt en guidant les émigrants, tantôt comme éclaireur pour l’U.S. Army au Mexique, et tantôt en chassant un peu le scalp en solitaire. En 1850, il partit vers l’Ouest en Californie et, en l’espace de trois ans, y mourut d’alcoolisme.
Alors que KIRKER avait quitté la profession en 1850, ses émules ne tardèrent pas à se retrouver sur le terrain. La fin de la guerre contre le Mexique et la découverte d’or en Californie activait le flot d’émigrants et d’aventuriers à travers le Sud-Ouest américain et la frontière Nord du Mexique. Les nouveaux venus provoquèrent de la part des Apache des actes de sauvagerie encore plus grands qu’avant, ceux-ci les voyant comme une nouvelle vague d’envahisseurs qui violaient leur territoire. Beaucoup de ces argonautes, en atteignant le Rio Grande à El Paso ou Presidio, se rendaient compte que leur porte-monnaie était vide. Par nécessité, certains s’orientèrent donc vers le commerce du cheveu pour gagner de quoi continuer le voyage jusqu’en Californie. En 1850, les gouvernements de Chihuahua, de Sonora, de Durango et de Coahuila avaient tous décrété des variantes de la Ley Quinto, la Cinquième Loi. Essentiellement des répétitions des vieux statuts sur la chasse aux scalps, les nouvelles lois resteraient en application jusqu’en 1886. Comme avant, des récompenses étaient proposées à la fois pour les scalps et pour les prisonniers, avalisant ainsi un meurtre en masse et un esclavage pour combattre la menace des Indiens. Rien que pour l’année 1849, l’Etat de Chihuahua dépensa dix sept mille huit cent quatre vingt seize Pesos en primes, et le commerce continuait de fleurir.
De nouveaux hommes ne tardèrent pas à signer des contrats pour parcourir la frontière à cheval à la recherche de primes. La « vermine rouge » promettait une fortune pour ceux qui voulaient associer la soif de sang à l’avidité. Deux des pires de ces nouveaux adeptes sortirent des rangs des Texas Rangers. Au cours de carrières aussi courtes que sans pitié, ils apportèrent de nouvelles dimensions à l’horreur de ce type de commerce. L’un des premiers à se distinguer fut Michael H. CHEVAILLE, un vétéran des Texas Rangers qui avait accompagné le Général Zachary TAYLOR dans sa charge vers l’intérieur du nord du Mexique, au cours de la guerre qui venait de finir. Ce CHEVAILLE attrapa la fièvre de l’or et forma une caravane d’immigrants à San Antonio pendant l’été de 1849. A court de fonds, ils choisirent d’aller à la chasse aux scalps au Mexique pour financer leur voyage et continuer vers l’Ouest. CHEVAILLE se battit à plusieurs reprises avec les Apache et les Comanches dans l’ouest du Texas et au Chihuahua. Un article de journal crédita même sa bande de la mort de quarante Indiens et de la capture de deux cent prisonniers au cours d’une bataille à la mi-Juillet. Le Texan fut heureux de toucher l’argent de la récompense, et reprit sa route vers le Pacifique. En Octobre, ses affaires s’étaient écroulées et peu de temps après, il tomba dans une dépression qui se termina en suicide.
L’un des concurrents de CHEVAILLE était d’une autre trempe, et ne manqua jamais de crier le décompte de ses victimes sous tous les toits. Comme CHEVAILLE, John Joel GLANTON avait servi au Mexique, mais même avant cela, il avait déjà acquis une funeste réputation. Un événement bien typique eu lieu dans un saloon de San Antonio un jour de 1846, quand GLANTON et un autre de ces hommes de la frontière se disputèrent à propos de cartes. Son antagoniste dégaina un pistolet, mais celui-ci fit long-feu. Et pif, pas boum !
GLANTON sortit son gros Bowie et décapita pratiquement le joueur adverse d’un simple et unique coup de couteau. Il essuya ensuite calmement le sang de la lame sur son pantalon de peau tout graisseux, et remit l’arme dans son fourreau en disant « Etrangers ! Quelqu’un veut-il continuer la bagarre ? Si oui, qu’il sorte. Sinon, on boit ! » Personne n’osa relever le défi, et on brassa de nouveau très vite les cartes. Né en Caroline du Sud, GLANTON était arrivé au Texas alors qu’il était encore très jeune. Au début de sa vie, c’était un homme très religieux, d’une moralité rigide. Puis sa fiancée fut enlevée et assassinée par les Apache, et GLANTON se transforma en un tueur vorace et assoiffé de sang, qui se moquait de toute religion excepté celle de la poudre, de la capsule de fulminate et de la balle de plomb. Lorsqu’un jour, deux ecclésiastiques déclenchèrent involontairement sa fureur à San Antonio, il s’engouffra dans leur maison sur son cheval et tenta de les tuer avec son revolver. Leur seule faute avait été de lui rappeler qu’il avait renié sa foi. L’été de 1849 vit GLANTON marié avec une jeune Mexicaine de bonne famille, mais on le connaissait toujours comme l’homme « qui avait tué dix hommes juste pour le sport ». Cet été-là, GLANTON déserta sa jeune mariée et s’en fut recruter sa propre bande de diables fous pour le suivre vers le Chihuahua. Les trente neuf brutes battirent la campagne à travers cet Etat et les régions avoisinantes, à la recherche de leurs proies. Au canyon de Santa Helena sur le Rio Grande, l’équipe de GLANTON surprit un campement Apache et poursuivit les Indiens pendant une bataille qui dura toute la journée. A la tombée de la nuit, ses hommes avaient récolté deux cent cinquante scalps sur les braves massacrés, sur les femmes et sur les enfants. Cet automne-là, il parcourut les montagnes du Chisos dans le Texas, et réussit presque à tuer le chef GOMEZ, l’un des plus féroces dirigeants des Apache Mescaleros. GOMEZ se vengea en prenant en embuscade tous les émigrants qu’il pouvait sur la route d’El Paso. A la fin de sa première campagne au cours de cet automne sanglant de 1849, les autorités Américaines sur la frontière condamnèrent les agissements de GLANTON. Un officier supérieur se plaignit par écrit à ses supérieurs de Washington : « Une bande d’Américains s’est engagée au service de l’Etat de Chihuahua pour tuer et anéantir des Indiens… Ces hommes sont entrés récemment sur notre territoire près de Presidio del Norte, et ils ont tué et scalpé un certain nombre d’Indiens pacifiques et amicaux… ce qui a tellement exaspéré les Indiens tout le long de la frontière, que la vie de tout homme Blanc qui pourrait tomber entre leurs mains sera le prix à en payer … on ne peut s’attendre à rien d’autre qu’une hostilité générale de la part des Indiens contre les Blancs, en réaction à la conduite indigne de ces mercenaires dépravés qui portent le nom d’Américains. » Il est facile de comprendre qu’à sa seconde incursion, GLANTON trouva les Indiens bien difficiles à rencontrer. Il choisit un stratagème profitable en massacrant des campements de Mexicains isolés, camouflant les faits en du travail d’Indien. Ses hommes découpaient ensuite les scalps des pauvres paysans qu’ils venaient de tuer, dans l’intention de les faire passer pour des trophées pris sur des Indiens. C’est la faute de ces mexicons, ils n’avaient qu’à ne pas ressembler à des indiens ! La ruse paya à plusieurs reprises, mais devint bientôt suspecte aux yeux des autorités de Chihuahua, qui finirent par poursuivre GLANTON et sa bande pour meurtre. Se rendant compte que la partie était finie dans le coin, les tueurs partirent vers le Nord pour le Sonora, ne manquant pas une escarmouche en cours de route avec des Mexicains ou n’importe quels Indiens, les uns et les autres faisant l’affaire une fois qu’il n’en restait que le scalp. Depuis son nouveau quartier général qu’il avait établi dans le vieux village de Fronteras, GLANTON recruta de nouveaux hommes parmi la population grandissante de Tucson.
Une colonne du 2ème. U.S. Dragoons se trouvait à Tucson à cette époque et l’agent de GLANTON, surnommé « Crying Tom » HITCHCOCK, arriva à convaincre un jeune Bostonien appelé Sam CHAMBERLAIN de déserter de son poste de charretier pour l’armée. Lui-même un vétéran au service des Dragons lors de la guerre contre le Mexique, CHAMBERLAIN apporta à la bande de GLANTON plus que son œil averti et son bras fort. Comme il se faufilait en dehors du camp ce soir-là, un Colt Walker pendait à sa ceinture et deux étuis pour pistolets à percussion étaient accrochés à sa selle, en même temps qu’une carabine Hall à chargement par la culasse. CHAMBERLAIN se croyait un aventurier aguerri, mais il se rendit vite compte que la sauvagerie dont ses nouveaux camarades faisaient preuve, et le mépris total qu’ils montraient pour la vie humaine, étaient pour lui épouvantables. A cheval avec HITCHCOCK alors qu’ils étaient en route pour Fronteras, ils rencontrèrent un jour une bande d’Apache, et CHAMBERLAIN blessa l’un des braves avec sa Hall. Le guerrier blessé préféra se jeter du haut d’une falaise, plutôt que de leur laisser son cuir chevelu.
« Putain ! Voilà cinquante Pesos qui partent en enfer, muchacho ! » jura « Crying Tom ». « Cette saloperie de conard de nègre rouge a fait ça exprès pour nous voler ses tifs ! » De retour au camp, CHAMBERLAIN se fit accueillir vertement, mais la compagnie le garda tout de même parmi elle. Il se rendit compte que les marginaux qui la constituaient n’étaient qu’un ramassis hétéroclite de « Mexicains du Sonora, d’Indiens Cherokee et Delaware, de Canadiens français, de Texans, d’un Noir et d’un Comanche pur-sang… équipés d’une vaste collection d’armes et d’équipements variés, et d’une diversité d’habillement rarement vues dans un corps normalement organisé pour la lutte contre les Indiens. » Bien que CHAMBERLAIN gagnât le respect de ses complices scalpeurs grâce à sa carabine Hall, il regretta vite sa décision d’en avoir rejoint la bande. GLANTON continuait son pèlerinage sanguinaire, tuant et scalpant aveuglément tous les voyageurs Indiens et Mexicains qu’il trouvait à sa portée. Un jour, quatre de ses hommes furent grièvement blessés lors d’un combat et incapables de continuer le voyage, et il ordonna calmement qu’on les abattît en s’en allant plus loin sur son cheval, pendant que ses camarades les achevaient à coups de casse-têtes Apache. Ce GLANTON avait manifestement sombré dans une folie meurtrière depuis longtemps, et CHAMBERLAIN commença à se sentir comme un prisonnier du gang plutôt que l’un des membres. Au printemps de 1850, il déserta GLANTON avec trois autres et partit vers la Californie. Entre-temps, GLANTON s’était installé sur les berges du Gila. Il y assassina plusieurs Indiens Pima et s’empara du bac que ceux-ci avaient installé, avec dans l’esprit de faire fortune en escroquant les émigrants désireux de passer de l’autre côté. Cette aventure parut prometteuse un petit moment, mais sa brutalité avait rendu les Pimas fous de rage et, le lendemain de la désertion de CHAMBERLAIN, ils attaquèrent le campement, y tuant GLANTON et les compagnons qui lui restaient. Les Indiens se saisirent du corps de l’ancien chasseur de scalps et « lui taillèrent les boucles jusqu’à la pomme d’Adam ». Ce fut une juste fin pour le sauvage Blanc.
Bien que le commerce du cheveu humain persistât encore au Mexique bien après la mort de GLANTON, les détails à ce sujet manquent à partir du début des années 1850. Des flibustiers américains comme Henry CRABB ou William WALKER effacèrent la bienvenue au Mexique pour le « Norte Americano » pendant une dizaine d’années, envisageant d’y graver leur empire privé en s’emparant de parties du Chihuahua ou du Sonora. Les primes pour les scalps restaient en vigueur, et des chasseurs Mexicains comme Juan Mata ORTIZ prirent la route, à la recherche d’Indiens. En 1860, cette pratique s’était étendue jusqu’aux Etats Unis. Cette année-là, un voyageur qui visitait l’Arizona rencontra des chasseurs de primes dont les « brides étaient brodées de cheveux humains provenant des victimes qu’ils avaient scalpées, et décorées des dents qu’ils avaient arrachées des mâchoires de femmes encore vivantes. » La tactique favorite était de laisser des provisions empoisonnées le long de pistes fréquemment empruntées par les Apache. Le résultat donnait aux couteaux des chasseurs une récolte facile et sans risques. La haine des Indiens était telle à cette époque, que les autorités américaines offrirent délibérément des primes sur tout le territoire de l’Arizona. En 1866, le journal « Miner » de Prescott annonça fièrement la formation des Yavapai County Rangers. Cette milice de trente hommes recrutait pour un service de quatre vingt dix jours, sous les ordres du chasseur d’Indiens Thomas HODGES. « Une coquette somme est allouée pour l’équipement, et aussi pour les scalps d’Indiens » pouvait-on lire dans le « Miner ». Une troupe de théâtre amateur réunit vingt cinq Dollars comme prime pour les Rangers, et on promit un scalp d’Apache à chaque femme de la compagnie théâtrale, en guise de remerciement de la part de la milice. Les Rangers coincèrent une bande d’Apache dans un canyon au Nord de Prescott, et abattirent vingt trois hommes, femmes et enfants. « Hourrah pour les Yavapai Rangers ! »exultait le « Miner ». « Nous sommes heureux de savoir que nos Yavapai Rangers ne se sont pas préoccupés de faire de prisonniers chez ces peaux-rouges sanguinaires. » Alors que certains tueurs d’Indiens préféraient leurs vieilles pétoires, des armes neuves arrivaient du Sud-Ouest pour les aider dans leur campagne contre les Apache. Le célèbre « Sugar-foot Jack » préférait son Colt Dragoon en .44 pour abattre ses proies, mais l’été 1863 vit des carabines à répétition Spencer passer à travers le territoire, lesquelles gagnèrent l’approbation immédiate de tous les hommes de la frontière qui en voyaient une. En 1868, le James HOBBS vieillissant donnait toujours dans le commerce du cheveu humain, et il se servait à la fois de la Spencer et d’une Henry à répétition en .44 annulaire. Un jour de cette année-là, il ramena un paquet de neuf scalps dans Fort Buchanan et proposa de signer un contrat avec le gouvernement pour en rapporter plus sur le territoire.
Le Gouverneur John M. GOODWIN et son successeur, A.P.K. SAFFORD étaient tous les deux en faveur d’une élimination de la menace Indienne aussi rapide que possible de l’Arizona. Entre 1869 et 1877, le gouvernement d’Etat reçut presque un millier de Springfield en .45-70 et en .50-70 du gouvernement fédéral. Un autre lot de cinq cent Sharps et Spencer à chargement par la culasse entra également dans l’arsenal d’état pendant cette période. Les armes furent librement distribuées parmi les citoyens, et elles eurent leur place dans les plus violents assauts contre les Indiens.Putain ! Tu imagines un peu ce que cela serait en France si on donnait gratuitement comme ça des .50-70 à tous les braves gens qui voudraient éliminer la vermine ratagasse ? Je vois bien ces gros morceaux de plomb pur, généreusement frottés à l’ail pour être bien sûr que ça s’infecte sur les blessés, en même temps que le saturnisme, les résidus de salpêtre et de soufre de la poudre noire, et puis aussi pour être sûr qu’ils ne reviennent pas du monde des morts, qui entreraient méchamment dans le corps de tous ces mauricots en leur brisant les os. Ouah ! Ouah ! Au mois d’Avril 1871, le Lieutenant Royal E. WHITMAN du 3ème U.S. Cavalry avait réussi à rassembler plusieurs centaines d’Apache pacifiques dans une réserve à Camp Grant, à quelques cinquante miles au Nord-est de Tucson. La présence des Indiens dérangeait trop les colons du coin, et ils décidèrent de passer à l’action. On sortit des caisses entières de Sharps et de Spencer des magasins du Gouverneur SAFFORD, et on en dota une troupe de cent quarante Blancs, Mexicains, et Indiens Papago. Au matin du 30 Avril, ils s’abattirent sur les Indiens sans défense et s’appliquèrent à les massacrer. Lorsque tout fut fini, pas moins de cent vingt cinq Apache gisaient sur le sol, morts. On ne compta parmi eux que huit hommes, et des douzaines d’enfants avaient été emmenés vivants pour être vendus sur le marché aux esclaves de l’autre côté de la frontière. Ce fut-là l’une des atrocités les plus graves commises dans l’histoire de la frontière Américaine. La haine et l’avidité s’étaient combinées dans le massacre de Camp Grant, et déclenchèrent une nouvelle Guerre Indienne en Arizona. A l’Est, les choses n’allaient pas mieux. Au Nouveau Mexique, l’agent chargé de la réserve Apache de Canada Alamosa, se plaignit que « des bandes qui viennent du Chihuahua et qui touchent des primes pour les scalps d’Indiens, sont aussi autorisées à chasser l’Indien sur le Territoire ( du Nouveau Mexique ). Il y a quelques jours, une petite troupe venant de Janos au Chihuahua a failli attaquer ces Indiens… Il sera impossible d’établir une paix permanente avec ces Indiens si on permet à des bandes incontrôlées de venir de l’Ancien Mexique pour errer comme elles le veulent et venir attaquer tous les Indiens qu’elles vont trouver, où et quand elles le voudront, et en toutes circonstances. Les gens, eux aussi, qui chassent les Indiens pour les quelques malheureux Dollars qu’ils reçoivent pour un scalp… Un Indien pacifique vaut… autant qu’un autre. » Le carnage continuait à s’étendre depuis l’ancien Mexique. A la fin de l’automne 1871, une troupe de scalpeurs quitta Presidio del Norte sur la frontière et pénétra dans le nord du Texas, aussi loin que les ruines de Fort Lancaster, sur les berges du Pecos. Il se heurtèrent à une bande d’Indiens et tuèrent deux braves. Dix squaws et enfants furent ramenés comme un troupeau à Presidio. De là, « ils furent acheminés vers Chihuahua, où le gouvernement paye une récompense de soixante quinze Dollars par tête. Les scalps rapportent deux cent cinquante Dollars. Ces Mexicains abordent la question Indienne avec raison. » pouvait on lire dans le journal « Austin Democratic Statesman ». Démocratique à sens unique, comme aujourd’hui en France entre les « corrects » d’un côté, et le reste de l’autre. Rien n’a changé ; tout est relatif. L’attitude des Texans était partagée par les gens de la frontière, plus loin vers le Nord au fur et à mesure qu’ils se heurtaient aux tribus autochtones de la région. Un citoyen de Denver sur le Territoire du Colorado, offrit une prime de dix Dollars par scalp de guerrier. A Central City, les colons réunirent une somme de cinq mille Dollars pour l’achat de scalps à vingt cinq Dollars la pièce.
Mais le Mexique restait le centre de l’industrie du scalp au fur et à mesure que passaient les années 1870. Le transporteur Texan August SANTLEBEN se rappelle qu’en visitant Chihuahua city en 1874, il avait trouvé que la prime de deux cent cinquante Dollars avait toujours cours. Le Gouverneur Luis TERRAZAS était déterminé à tuer ou jeter en dehors de l’Etat tous les Apache qu’il restait dans les collines. Un jour, SANTLEBEN y vit une bande d’Apache pacifiques défiler dans les rues, de retour d’une expédition contre des hostiles. Les braves portaient fièrement de longs bâtons aux bouts desquels ils avaient fixé des scalps d’autres Apache. Derrière eux marchaient les femmes et les enfants qui avaient été faits prisonniers sur la bande attaquée, et destinés à être vendus comme esclaves. Les braves citoyens bien pensants passèrent le restant de la journée à faire la fête, pendant que les Indiens ramassaient l’argent que le gouvernement leur devait pour leurs trophées.
Les Mexicains et leurs alliés Indiens étaient parfois organisés en milices, armées par le gouvernement, mais se chargeant eux-même de leur paye avec les primes ramassées pour les scalps. Les « Nacionales », comme on les appelait, fournissaient leurs propres armes ou portaient les fusils et carabines à chargement par la culasse Remington d’ordonnance en 11 MM utilisés par l’Armée Mexicaine. La République du Mexique avait aussi acheté des lots de carabines Spencer en .56-50 annulaire et des Winchester en .44-40. Les armes de poing d’ordonnance étaient les Smith & Wesson en .44 annulaire et en .44 Russian. Des quantités moins importantes de Colts et de Remington en .45 étaient également en dotation chez les miliciens. Les « Nacionales » étaient des hommes hardis et de bons combattants lorsqu’ils étaient convenablement menés. Un Texas Ranger qui travailla quelque temps avec les Chihuahenos fit d’eux cette description : « Des cavaliers, bien armés de pistolets et de carabines Remington, portant de bons uniformes et montés sur des animaux de même taille et à la robe foncée. L’infanterie était composée d’Indiens provenant de l’intérieur du Mexique. Ceux-là portaient aux pieds des sandales de cuir et ils étaient armés de fusils Remington. Chaque soldat portait deux cartouchières contenant cent cartouches. J’étais impressionné par le peu de bagage et de rations que portaient ces hommes. En marche, chaque homme avait un petit sac de toile contenant environ un quart de farine de maïs, adouci avec un peu de sucre, et une cuiller de cette mixture mélangée à une pinte d’eau leur faisait un bon repas. Ce peu de bagages et de rations leur permettait de se déplacer rapidement. L’infanterie n’avait aucun mal à garder la cadence avec la cavalerie pendant la marche, et en terrain difficile, elle progressait plus vite que les hommes à cheval. » Les « Nacionales » prirent une place importante dans l’une des dernières grandes révoltes Indiennes du Sud-Ouest. En Août 1879, le chef Apache VICTORIO s’enfuit de la réserve de Warm Springs, Nouveau Mexique, et mena sa suite dans une série de pillages qui allaient laisser les deux côtés de la frontière en révolte pour l’année à suivre. VICTORIO lançait ses raids de façon répétée à la fois au Mexique et aux Etats Unis, tuant les hommes et volant les chevaux et les provisions pour subvenir aux besoins de sa rébellion. Ni les troupes Mexicaines, ni les troupes Américaines, ne purent jamais garder sa trace assez longtemps pour se rapprocher de lui quand il se retirait dans ce sanctuaire qu’étaient les montagnes au Nord du Chihuahua. En Septembre 1880, le gouvernement du Chihuahua offrait une récompense de mille Dollars rien que pour le scalp de VICTORIO, et l’offre était affichée des deux côtés du Rio Grande. Le Colonel des « Nacionales » Joaquin TERRAZAS mit son régiment en marche, déterminé à vaincre VICTORIO. TERRAZAS, lui-même un ancien scalpeur, fut rejoint par Juan Mata ORTIZ, un autre expert dans ce genre d’affaires. Après une longue poursuite, ils coincèrent la bande de VICTORIO à Tres Castillos et donnèrent l’assaut au campement le 15 Octobre. Le fusilier Mauricio CORREDOR tua le chef Indien au cours de la bataille et, à la fin de celle-ci, les hommes de TERRAZA revendiquaient soixante seize scalps et soixante six prisonniers pour le marché aux esclaves. Le Colonel rassembla dix sept mille deux cent cinquante Dollars pour les scalps, et dix mille deux cent Dollars pour la bande de captifs. CORREDOR réclama la prime pour les cheveux de VICTORIO, et le gouvernement reconnaissant lui offrit un superbe fusil Sharps entièrement nickelé. Pendant les six années suivantes, des révoltes Indiennes du même type s’allumèrent de façon répétitive au Mexique et aux Etats Unis, des durs comme JUH, NANA et GERONIMO menant leurs braves dans de derniers et amers combats contre leurs ennemis. GERONIMO revendiqua le scalp de Juan Mata ORTIZ en 1882, et CORREDOR mourut au cours d’une attaque mal lancée contre des éclaireurs Apache de l’U.S. Army en 1886. La dernière des grandes guerres Apache se termina par la défaite finale de GERONIMO à la fin de cette année-là. Des poches de résistance d’hostiles survivraient bien encore dans le désert montagneux du Mexique jusqu’au vingtième siècle, mais le temps des chasseurs de scalps était révolu pour toujours des deux côtés de la frontière. Les historiens s’accordent pour dire que le commerce du cheveu humain prolongea plus les violences entre les Blancs, les Indiens et les Mexicains, que tout autre facteur. L’avidité et la haine nourrirent chaque côté sans relâche pendant cinquante ans avant que la tragédie ne cessât. A travers elle, des armes comme le revolver Colt, la carabine Spencer et le fusil Hawken portèrent le fardeau macabre que leur avait donné le travail de leurs propriétaires. Bien que de moindre importance, c’est aussi une autre tragédie pour cette époque qu’aussi longtemps que la Ley Quinto resta en vigueur, des armes bien huilées et polies pour leurs tâches sanguinaires aient été portées par des hommes dont la conscience était piquée de rouille. Ouf ! Bon et moi, maintenant, je vais aller prendre un pot. J’avais rendez-vous chez le coiffeur, mais après avoir lu cette histoire, je préfère attendre encore un peu. C’est un Indien…
LE ROI DES CHASSEURS DE SCALPS
Traduction d’un article de Michael MARSH paru dans D.G.W. Blackpowder Annual 1993
Un jour d’été 1848, l’aventurier Anglais George Frederick RUXTON arrivait à cheval sur la place centrale de Chihuahua City, Chihuahua, Mexique, et il fut frappé par une vision macabre. Pendant comme des ornements funestes sur la façade de la cathédrale, des scalps, de longs scalps noirs d’Apache, se balançaient doucement dans la brise du désert. RUXTON en compta cent soixante dix en tout et, sans cacher son dégoût, écrivit dans son livre « Aventures à travers le Mexique et les Montagnes Rocheuses » que « les Apache avaient été récemment massacrés traîtreusement et de manière inhumaine par des chasseurs d’Indiens payés par l’Etat. Les scalps d’hommes, de femmes et d’enfants ont été apportés en ville au cours d’une procession, et suspendus comme des trophées, cette situation montrant la valeur et l’humanité Mexicaine. » Ces « chasseurs d’Indiens » étaient conduits par James KIRKER, un Irlandais qui avait vécu vingt ans au Mexique. Il avait été engagé par le gouverneur du Chihuahua, Angel TRIAS, comme chasseur indépendant d’Indiens, et il était payé deux cent Pesos d’argent par scalp. Les scalps qui décoraient la cathédrale avaient appartenu à la bande Apache du chef REYES, lequel avait été écrasé près de Galena dans le Nord du Chihuahua, au début du mois de Juillet. A l’époque de la visite de RUXTON, les Apache terrorisaient le frontière Nord du Mexique depuis presque un siècle. Lançant des raids gratuits, pillant villages et ranches et assassinant des milliers d’habitants. A l’époque où les colons américains se battaient pour leur indépendance, les Espagnols essayaient de mener une guerre contre les Apache. Mais les Espagnols se rendirent compte que leurs stratégies et leurs tactiques classiques étaient inefficaces contre les Apache, lesquels étaient d’excellents combattants de guérilla qui évoluaient dans leur propre élément. Malgré quelques victoires isolées obtenues par les Espagnols, les campagnes manquaient généralement de résultats durables. Après la Révolution Mexicaine de 1821, un climat de politiques turbulentes laissa les nouveaux régimes encore moins capables de gérer le problème. Situé à un millier de miles plus au Sud dans la ville de Mexico City, le gouvernement central était peu disposé à apporter de l’aide, qu’elle fût d’ordre financier ou militaire, pour protéger les citoyens, et préférait laisser le problème aux Etats eux-mêmes. Le sang continua donc de couler sans espoir d’amélioration, et la vie et le commerce sur la frontière en arrivaient au point mort. Les ranches étaient délaissés, les mines abandonnées. En fait, des colonies entières devinrent des villes fantômes. Même les habitants des villes n’étaient pas en sécurité : de 1832 à 1849, quelques deux cent personnes furent massacrées par les Apache dans les rues de Fronteras, Sonora, et des citoyens étaient assassinées de façon routinière dans la ville et autour, de Chihuahua City.
Au printemps de 1831, en réponse au mécontentement grandissant des citoyens, le Président du Mexique envoya le Colonel José Joaquin CALVO prendre le commandement militaire de la région en colère. Soldat et administrateur compétent, CALVO devint gouverneur du Chihuahua en Septembre 1834. Il tenta d’abord de résoudre le problème en essayant de faire la paix avec les Indiens. Quand cette stratégie échoua, il lança une campagne militaire contre eux. Celle-ci se solda par aussi peu de succès qu’avec les Espagnols cinquante ans plus tôt. Les troupes Mexicaines, d’abord mal entraînées et sous-payées, furent vite démoralisées et mises en déroute par les Apache, qui frappaient comme un feu de brousse et disparaissaient comme la fumée. Désespérés, les dirigeants mexicains reprirent les vieilles pratiques des Espagnols, en payant une prime pour les cuirs chevelus d’Indiens. En Septembre 1835, l’Etat de Sonora décréta le Proyecto de Guerra, lequel offrait cent Pesos pour le scalp d’un guerrier Apache. Ce n’était pas une petite somme dans les années 1830. En guise de stimulation, le chasseur de scalps pouvait garder tout le bétail ou ce qu’il avait pu piller en ramassant ses scalps. Au cours des années 1830, des troupes entières de trappeurs américains oeuvraient dans le désert tout autour du Rio Grande, où les cours d’eaux recelaient de riches récoltes en peaux de castors. Lorsque le marché de la fourrure s’écroula dans la deuxième moitié de la décade, cependant, beaucoup de ces trappeurs se rendirent compte qu’ils avaient besoin d’une nouvelle source de revenus. La nouvelle loi du Sonora sur les scalps étant prometteuse en matière d’activité lucrative, nombreux furent ceux qui choisirent de délaisser la chasse aux fourrures au profit de la chasse aux scalps.
Au Nouveau Mexique traînaient à cette époque-là plusieurs opportunistes, parmi lesquels un homme originaire du Kentucky et s’appelant John James JOHNSON. On a décrit JOHNSON de plusieurs manières, soit comme un homme des montagnes, soit comme un marchand de mules, soi comme un négociant en argent. Il choisit apparemment d’ajouter la chasse aux scalps à cette palette de métiers. Une bande d’Apache Mimbreño, conduite par le chef Juan José COMPA, avait suscité une colère considérable au Mexique. Après avoir lancé des raids dans Sonora et Chihuahua, Juan José et ses guerriers se retirèrent dans les contrées sauvages du Nouveau-Mexique, où ils avaient pu rester jusque là sans être poursuivis. JOHNSON, en compagnie de seize autres Américains, la plupart des trappeurs et d’autres aventuriers de la frontière, s’en furent à cheval, à la recherche des Apache. Le gouverneur du Sonora avait promis un bonus supplémentaire à JOHNSON s’il arrivait à lui rapporter le scalp de Juan José lui-même. En Avril 1837, JOHNSON et ses hommes repérèrent le campement de Juan José, constitué d’une centaine d’Indiens, dans les montagnes Anima dans le Sud-Ouest du Nouveau-Mexique. A cette époque, les Apache ne considéraient pas encore les américains comme leurs ennemis. Dans l’ensemble, ils avaient été tolérants avec les trappeurs Anglos, et en fait ils commerçaient souvent avec les Blancs, échangeant du bétail, spécialement des mules, qu’ils avaient pris lors de raids au Mexique, pour des armes, de la poudre, du plomb, des couteaux, du whisky et autres. C’est dans cet esprit que Juan José accueillit les américains dans son camp, pensant sans doute à faire un peu de troc. Mais JOHNSON avait autre chose en tête. Il était d’usage courant que les Blancs fassent des cadeaux avant une séance de troc, et JOHNSON avait déposé un peu plus tôt dans une clairière un sac de piñole, une farine de maïs très prisée par les Apache. Sur le côté, soigneusement caché sous un tas de selles et d’équipement, un petit canon avait été pointé directement sur le piñole. Le canon avait été chargé de bouts de fer, de clous, et de morceaux de chaînes. JOHNSON invita les Apache à se servir en piñole et, lorsqu’une foule d’hommes, de femmes, et d’enfants se fut rassemblée autour du sac, il approcha son cigare de la lumière du canon, lequel vomit horriblement et frappa les Indiens de plein fouet, comme un orage de grêle venant de l’enfer. Beaucoup furent tués, et beaucoup plus furent atrocement blessés. En ce qui concerne Juan José, JOHNSON et l’un de ses lieutenants avaient pris à part le chef qui ne se souciait de rien, sous un prétexte amical, et c’est là qu’ils l’assassinèrent. Lorsqu’on lui présenta les scalps, spécialement celui de Juan José, le gouverneur du Sonora jubilait. Avec le premier succès du Proyecto de Guerra, l’Etat du Chihuahua ne tarda pas décréter une mesure similaire. Le Chihuahua payerait cent Pesos pour le scalp d’un Apache, cinquante pour celui d’une squaw et, pour qu’il ne grandisse pas et ne devînt ainsi un trublion, vingt cinq Pesos pour celui d’un enfant de moins de quatorze ans. On s’en doute, l’incident ne fit rien pour améliorer les relations entre Apache et Américains. Tout ce qui eût pu exister de confiance entre ces races auparavant fut réduit à néant.
Une fois remis du massacre, les Apache enragés recommencèrent à verser le sang pour se venger et cette fois, les américains ne furent pas épargnés. La région du Santa Rita del Cobre abritait les mines de cuivre les plus riches du Sud-Ouest. Ouvertes vers 1800 par les Espagnols, les mines se trouvaient au Sud de la rivière Gila, en plein milieu du territoire Apache, à côté de ce qui est aujourd’hui Silver City, Nouveau-Mexique. Déjà en 1806, les mines produisaient jusqu’à dix tonnes de minerai par jour, mais il n’y avait pratiquement pas un jour qui passât sans une attaque Apache, et garder les mines en opération était un combat permanent. Le chemin menant à Santa Rita était une piste allant vers le Sud-Est vers la ville de Chihuahua City et traversant le village Mexicain de Janos. C’était par là que passaient les caravanes de mulets, appelées « conductas », pour apporter les vivres de la ville vers le Nord, et transporter le minerai vers les fours dans le Sud, au Nord de la province du Chihuahua. Malheureusement, la route croisait une piste de guerre Apache, et les « conductas » faisaient constamment l’objet d’attaques. Lorsqu’en 1827, les mines de Santa Rita passèrent sous la direction de Robert Mc. KNIGHT et Stephen COURCIER, les Apache avaient ralenti leurs attaques. Mc. KNIGHT et COURCIER étaient des Américains venus de St. Louis, qui arrivèrent à exploiter les mines avec succès pendant une dizaine d’années, les transformant en des entreprises assez profitables. Vers 1837, ils récoltaient jusqu’à 2 000 $ par jour. Cette prospérité avait été rendue possible grâce aux efforts d’un homme, James KIRKER, que Mc. KNIGHT et COURCIER avaient engagé comme chef de leur service de sécurité.
KIRKER était de descendance écossaise et irlandaise, il était né à Belfast en Irlande du Nord, en Décembre 1793. Il arriva aux Etats–Unis à l’age de seize ans, et fit la guerre en 1812. Plus tard, il se rendit à New-York City, où il se maria, eut un fils, et devint épicier. En 1817, KIRKER abandonna sa famille et quitta New-York, se dirigeant vers St. Louis, où il épousa de nouveau le métier d’épicier. Cinq ans plus tard, il montait à bord d’un bateau, probablement l’expédition ASHLEY-HENRY, et remonta la rivière Missouri vers le Lointain Ouest. Là, KIRKER posa des pièges pour les castors et se battit contre les Indiens, revenant de temps en temps à St. Louis pour surveiller son magasin et s’occuper des affaires. En 1824, il accompagnait les caravanes de marchands vers Santa Fe, et posait des pièges comme trappeur au fin fond du Nouveau Mexique. Les années suivantes virent KIRKER rejoindre des expéditions de trappeurs à Bent’s Fort, et travailler sur la région de la rivière Gila, allant aussi loin vers l’Ouest que sur la rivière Colorado. En 1825, il devint citoyen Mexicain et fit bientôt de Santa Rita son quartier général. Mc. KNIGHT et COURCIEr faisaient partie de ses amis depuis St. Louis, et les mines se trouvaient près des territoires où il posait ses pièges. En hiver, il faisait du trafic de fourrure. En été, il travaillait pour Mc. KNIGHT et COURCIER, dirigeant le service de garde des mines et des caravanes de « conducta ». KIRKER s’était lié d’amitié avec les Indiens au cours de toutes ses expéditions, et il était arrivé à les persuader de ne pas gêner les opérations à Santa Rita. En échange de leur coopération, il leur arrangeait des transactions au cours desquelles le bétail qu’ils volaient aux Mexicains était vendu sur les marchés de l’Est. Vers 1831, KIRKER épousa une Mexicaine, bien que sa femme fût encore à New-York, et s’installa à Janos. En 1835, il obtint un permis officiel de trappeur du gouverneur du Nouveau-Mexique Abino PEREZ. Avant cette époque, il avait piégé illégalement, chose dont les Mexicains le soupçonnaient mais qu’ils n’avaient jamais réussi à le prendre sur le fait. Ils le soupçonnaient également de trafiquer avec les Apache, un crime puni de la peine de mort. Au cours de la saison de chasse d’hiver, KIRKER découvrit que les Indiens préparaient l’attaque d’un campement de Mexicains et, peut-être pour se racheter, fit part du complot aux autorités Mexicaines. Cependant, le gouverneur CALVO, voyant l’occasion de coincer KIRKER, usa de son influence politique pour convaincre PEREZ d’annuler le permis de KIRKER, et de l’arrêter pour avoir organisé l’attaque lui-même. C’est comme dans un film de Zorro, où il y a toujours un pourri. Ca sent le Zorro. Et comme « zorro » en espagnol veut dire « renard », ça veut aussi dire que ça renarde sec. Et quand on sait comment ça sent, un renard, on dit que ça pue. Et bien. Sans se soucier de cette affaire, KIRKER partit pour Santa Fe, en emportant avec lui les fourrures prises au cours d’un hiver généreux en la matière, quand des Indiens les lui volèrent. Lorsqu’il demanda de l’aide pour récupérer ses peaux et ses mules, il s’aperçut avec surprise qu’il était lui-même recherché, avec sa tête mise à prix pour huit cent Pesos, mort ou vif. Heureusement, le soldat qui fut désigné pour le garder était un vieil ami qui l’aida à s’échapper, et il s’enfuit pour Bent’s Fort. Pendant ce temps-là, ses biens, d’une valeur de 32 900 $, finissaient dans les mains du gouverneur PEREZ, lequel empocha l’argent. Ah le salaud ! Je le savais bien, que les Mexicons étaient des tordus. Avec Pérèz, t’es de la baise, et sans chaise. Pérèz Ibèz Sanchèz ! Toutes les protestations de KIRKER ne servirent à rien. Amer, il n’oublia jamais cet événement.
Enragés par le massacre de JOHNSON, les Apache obligèrent les mines de Santa Rita à fermer. Mc. KNIGHT et COURCIER étaient convaincus que seule l’aide de KIRKER arriverait à les faire rouvrir. Vers la fin de l’été de 1837, ils lui envoyèrent un message à Bent’s Fort, où il était toujours en exil. Cette demande faisait toutefois suite à un incident qui permettrait son retour au Nouveau-Mexique. Une révolte au mois d’Août à Santa Fe se termina avec la tête du gouverneur PEREZ roulant dans le caniveau. Le nouveau gouverneur, Manuel ARMIJO, offrit l’amnistie à KIRKER et l’invita à revenir. En réponse à l’appel de Santa Rita et avant de quitter Bent’s Fort, KIRKER rassembla une armée hétéroclite de vingt et un hommes, dont beaucoup étaient des Indiens Delaware et Shawnee. Les autres étaient des hommes des montagnes d’origine américaine ou française. Il y avait un gigantesque Africain nommé « Andy ». Le lieutenant de KIRKER était un imposant demi-sang Shawnee, dont l’autre moitié était Française, qui s’appelait SPYBUCK. Tout ce que KIRKER demandait, semblait-il, était la volonté de se battre. Au fur et à mesure que la bande de racaille se dirigeait vers le Sud, KIRKER se rendait compte que ses bons rapports avec les Apache s’étaient envolés avec la fumée du canon de JOHNSON. A présent, la force restait le seul moyen de traiter avec eux.
Il connaissait un village d’environ deux cent cinquante Apache, non loin de la ville Mexicaine de Socorro. L’armée de KIRKER manœuvra en dehors du village dans l’ombre précédant l’aube et, dès les premières lueurs, frappa d’un grand coup vicieux. Comme les Indiens se levaient en vacillant de leurs couvertures, ils étaient chargés par les cavaliers, et assommés par les casse-têtes ou percés par les lances des Shawnee et des Delawares. Les hommes des montagnes firent feu de leurs fusils sur les guerriers qui atteignaient leurs poneys. Le reste des villageois s’enfuit en paniquant dans les broussailles à l’entour. En tout, les hommes de KIRKER comptèrent cinquante cinq Apache, alors qu’ils n’avaient eux-mêmes perdu qu’un homme, huit autres étant blessés. Ils capturèrent neuf femmes et quatre cent têtes de bétail. KIRKER agrippa l’un des Apache qui tentaient de s’enfuir, et lui dit de répandre la nouvelle : « Laissez les mines de Santa Rita et les caravanes de conductas tranquilles, sinon on recommence ». L’attaque eut l’effet désiré. Les harcèlements d’Apache sur les mines cessèrent. Le mot passa de bouche à oreille à travers tout le territoire, et la population auparavant accablée l’acclama comme un sauveur. Ils l’appelèrent « Don Santiago QUERQUE », « El Rey de Nuevo Mexico », le Roi du Nouveau-Mexique. L’attention que l’on portait à KIRKER pour son brillant succès resta sur l’estomac du gouverneur CALVO et déplut à l’Armée Mexicaine. Quand KIRKER se présenta à Chihuahua City avec cinquante cinq scalps, sans aucun doute il frottait le nez de certains dans des cheveux d’Apache. Mais les Mexicains avaient besoin de Don Santiago et ils le savaient. Leur armée continuait à se faire humilier par les Apache, lesquels assassinaient ouvertement des citoyens en plein jour, et tout près du palais du gouverneur. Une rapide série d’administrations d’incapables suivit la mort de CALVO en Février 1838. Puis, à l’été de 1839, des mesures plus déterminées furent prises avec le gouvernement de José Maria de IRIGOYEN, pour gérer une situation qui se détériorait rapidement. Stephen COURCIER était à présent un homme riche et influent à Chihuahua City. COURCIER se rendit chez le gouverneur avec un projet d’établir une cellule de crise dans le but de financer une armée, qui serait bien-sûr commandée par KIRKER, pour combattre les Apache. On fonderait une association qui réunirait des dons privés. Le but était d’atteindre 100 000 $. IRIGOYEN approuva son plan et chargea COURCIER de le mettre en pratique. COURCIER créa la Sociedad de Guerra Contra Los Barbaros, ou Société de Guerre Contre Les Barbares, et lança un appel à travers tout le pays ravagé pour réunir les contributions. L’argent vint de toutes parts. KIRKER reçut une avance de 5 000 $ et ne perdit pas de temps à rassembler une armée. Elle alignait cinquante hommes, comprenant les membres de son ancienne bande, renforcés de nouvelles recrues trouvées à Bent’s Fort et à d’autres endroits. Il choisit de les appeler « Old Apache Company », ou « Bonne Vieille Compagnie pour Apache ». Les hommes étaient payés un Dollar par jour, plus une part de la moitié de ce qui serait pillé. KIRKER, SPYBUCK et leur O.A.C. furent au travail avant la fin de l’été.
Se rappelant peut-être l’incident où on lui avait dérobé ses fourrures et ses mules deux ans plus tôt, KIRKER imagina un plan où un troupeau de chevaux et de mules serait utilisé comme appât pour provoquer un raid. Le stratagème fonctionna. L’histoire est relatée dans l’édition du journal New Orleans Picayune le 28 Février et le 02 Mars 1840, par Matt FIELD. Dans l’article, KIRKER est décrit comme « un homme de dispositions courageuses et téméraires à la fois ». Plus loin, il raconte comment KIRKER et ses hommes campèrent près du petit village de montagne de Ranchos de Taos et comment les Apache, sous le couvert de l’obscurité, s’approchèrent en rampant et s’emparèrent de l’appât, pensant sûrement qu’ils dévalisaient un groupe de marchands. KIRKER s’attendait à ce que les Apache, forts de quelques cent vingt braves, tenteraient de s’enfuir par un ravin qui coupait à travers la montagne. Il mena rapidement ses hommes sur les falaises et, en contournant les Apache, les déploya plus haut le long des flancs du ravin. Depuis le lieu qu’il avait choisi pour l’embuscade, on avait une vue générale de l’endroit par où passeraient les Apache. Bientôt les Apache apparurent, poussant le troupeau de bêtes volées, ignorant ce qui les attendait. Chacun des hommes de KIRKER choisit sa cible et les armes grondèrent soudain, remplissant le canyon d’une fumée bleue d’où s’échappaient les cris horribles des hommes et des chevaux. Quand la fumée se dissipa, un désordre indescriptible se déroulait en bas, avec une vingtaine d’Indiens touchés, certains se faisant traîner et d’autres piétiner par les chevaux paniqués. Les autres firent demi-tour et s’enfuirent sauvagement dans le canyon, avec l’armée de KIRKER à leurs trousses. Les Indiens fuyards cherchèrent désespérément refuge dans Ranchos de Taos. Les hommes de KIRKER les y renversèrent au sol et commencèrent à les massacrer dans les rues.
C’était encore tôt le matin, et la mêlée d’enfer tira vite de leur lit les villageois effrayés. Quelques uns des Indiens se réfugièrent dans l’église, pensant peut-être qu’ils seraient protégés par le lieu sacré. Mais les hommes de KIRKER les poursuivirent partout où ils essayaient de se cacher, et les abattirent sans façon. Le combat dura une demi-heure, et environ quarante Apache furent tués, pour deux hommes de perdus du côté de la bande à KIRKER. Dans son article, le journaliste FIELD dit de KIRKER qu’il était « brave comme un lion et un homme de grande envergure et d’une grande habileté dans ce genre de guerre ». L’armée victorieuse de KIRKER était forte de cinquante neuf hommes lorsqu’elle chevaucha par El Paso en Novembre, vers le Sud pour Chihuahua City. Bien qu’ils fussent salués en héros, ils devaient avoir un air barbare, ces hommes sauvages, barbus, avec leurs vêtements en peaux tachés de sang, les Shawnee et les Delawares à demi-nus avec leur torses ornés de rouge, certains portant une crinière noire hirsute, d’autres le crâne rasé surmonté d’un nœud dans lequel étaient lacées des plumes d’oiseau de proie. Ils portaient à leur ceinture de grands couteaux Bowie et des plus petits, des couteaux à écorcher. Beaucoup avaient un pistolet à percussion de type Kentucky, et quelques uns possédaient sûrement le nouveau Colt à cinq coups, appelé le Texas Paterson. Le casse-tête court et lourd avec lequel ils exécutaient leur travail macabre pendait à leur selle, accroché par une boucle en cuir cru. Les Indiens portaient des lances et des tomahawks bizarres. Et, posé à travers la plupart de leur selle, le gros fusil Hawken, sauf pour Andy, le géant noir, qui portait une « escopeta » chargée de chevrotines. Et là, en tête, monté sur un grand cheval bai, KIRKER lui-même, la cinquantaine et pas un petit poulet, les cheveux et la moustache grisonnants, portant un sombrero et des éperons espagnols avec de grosses et cruelles molettes. Son fameux Hawken, décoré en fantaisie au filigrane d’argent mexicain, était rangé dans son fourreau de selle. Quand la compagnie revint à Chihuahua, elle y trouva un nouveau gouverneur en place, bien qu’il portât un nom proche de celui de son prédécesseur. José Irigoyen de la O était un neveu de l’ancien IRIGOYEN et, comme son oncle, il défendait les chasseurs de scalps. Il paya rapidement KIRKER et lui prêta, à juste titre, l’arène à corridas pour que la compagnie pût y bivouaquer. Il demanda également à KIRKER d’augmenter les effectifs de son armée. KIRKLER s’exécuta et commença à recruter de nouveaux hommes. Mais les victorieux chasseurs d’Indiens, qui campaient devant tout le monde sur la Plaza de Toros, étaient la risée constante des dandy en uniforme rouge de l’Armée Mexicaine. En dépit d’une certaine rancune, les militaires ne pouvaient pas faire grand chose aussi longtemps que les hommes de KIRKER étaient efficaces.
Le problème était qu’ils pouvaient même devenir un peu trop efficaces. Selon les dispositions de l’accord signé avec la société de guerre, KIRKER avait le droit de propriété sur tout ce qu’il avait rapporté de chez les Indiens. Pourtant, les anciens propriétaires Mexicains du bétail, à présent leur terreur passée, commençaient à se plaindre et réclamaient que leur bien leur fût rendu. Des bruits se mirent à circuler, selon lesquels KIRKER prenait du bétail directement chez les Mexicains. Bien entendu KIRKER soutint le contraire, prétendant que le bétail en sa possession avait été volé par les Apache. Comme la dispute augmentait, l’opinion publique en faveur des chasseurs de scalps se mit à se détériorer, et les militaires n’hésitèrent pas à tourner l’affaire à leur avantage. Le gouverneur Irigoyen de la O mourut dans l’exercice de ses fonctions et fut remplacé en Juillet 1840 par Garcia CONDE, l’ancien Ministre de la Guerre. CONDE était issu d’une famille estimée de militaires, et l’un de ses actes fut de supprimer la Société de Guerre, décrétant qu’il était contre les intérêts nationaux que des mercenaires étrangers usurpassent le travail de l’Armée Mexicaine. CONDE se mit immédiatement à reformer sa police des frontières. Il pensait qu’une bonne démonstration de ses forces persuaderait les Apache d’arrêter leurs sévices. En essayant de négocier la paix, CONDE apprit ironiquement que la première des conditions que demandaient les Apache était l’élimination immédiate de l’armée de KIRKER. En plus de cela, on lui soumit une liste d’exigences outrageantes auxquelles CONDE n’avait pas l’intention de se soumettre. Entre temps, KIRKER partit pour Guadalupe y Calvo, une ville minière perdue dans le Sud-Ouest du Chihuahua, où il travailla comme chef de la sécurité. Sans l’armée de KIRKER, les Apache ne tardèrent pas à reprendre leurs massacres de Mexicains là où les avaient laissés. En dépit des meilleurs efforts de CONDE, les troupes mexicaines n’étaient tout simplement pas les mêmes combattants que les irréguliers de KIRKER. Quand le peuple recommença à se plaindre haut et fort, le Président Mexicain BUSTAMENTE remplaça CONDE par le Général Mariano MONTERDE en Décembre 1842.
MONTERDE ne perdit pas de temps et rappela KIRKER, lui proposant de le payer au tarif standard. La Old Apache Company ne fut pas longue à reprendre place dans l’arène. En été 1843, une caravane de mulets appartenant à J. Calistro PORRAS fut attaquée par une bande d’Apache, à environ douze miles à l’ouest de Chihuahua City. PORRAS était un riche marchand de Chihuahua et la caravane, comprenant quelques quatre vingt mules, revenait chargée de marchandises et d’alcool. Les guerriers tuèrent tous les « arrieros » sauf un, et s’enfuirent avec les mules et les marchandises. Quant l’unique survivant arriva en se traînant et raconta l’histoire à PORRAS, celui-ci se rendit tout droit à l’arène pour trouver Don Santiago. Il offrit au chasseur de scalps les mules et la moitié des marchandises s’il arrivait à trouver les pillards et les détruire. En imaginant l’argent supplémentaire que KIRKER se ferait avec les scalps, l’aventure pouvait se révéler assez lucrative. Derrière un guide Mexicain, la Old Apache Company, forte à présent de cent soixante dix hommes, chevaucha jusqu’aux lieux du massacre et trouva facilement la trace des pillards. Pendant trois jours, les hommes suivirent la piste des Apache en retraite, passant à côté des carcasses de mules mortes d’épuisement et de paquets de marchandises abandonnés en cours de route. Le troisième jour, SPYBUCK localisa le campement Apache. Il rapporta à KIRKER qu’il y avait quarante trois guerriers et que, se croyant hors de danger, ceux-ci avaient puisé dans l’alcool et commençaient à se soûler. Les poursuivants attendirent que les Apache fussent imbibés jusqu’à l’oubli total. Puis KIRKER et la moitié de ses hommes rampèrent aisément à l’intérieur du camp et leur coupèrent la gorge. Avant de revenir en ville, cependant, KIRKER proposa une chose à ses hommes. Il savait qu’un grand village d’Apache, d’un millier d’habitants, se trouvait à trois jours de cheval de l’endroit où ils étaient. Il proposa d’attaquer le village, dont les scalps et le bétail viendraient s’additionner en une petite fortune. Les hommes approuvèrent très vite. Dans la pénombre précédant le petit matin, presque tout le monde au village dormait ou était encore abruti. Les deux compagnies pénétrèrent dans le village, attendant le coup de sifflet de KIRKER qui devait donner le signal de l’attaque. Soudain, un coup de feu claqua avant que tous les hommes de fussent prêts. Alors qu’il rampait à l’intérieur du village, Andy avait été surpris par un Apache qui sortait de sa hutte au mauvais moment. Le Noir avait saisi son escopette et appuyé sur la détente. Chasseurs et guerriers prêts ou non, le combat débuta. Les hommes saccageaient tout dans le village, provoquant un horrible carnage parmi les habitants encore à moitié endormis. Ils tuèrent sans distinction. Les guerriers surpris furent abattus par des armes à feu, les femmes et les enfants étaient massacrés à coups de casse-tête, de couteaux et de hachettes. Beaucoup d’Apache qui arrivèrent à sortir des mains des hommes de KIRKER s’enfuirent en paniquant vers le lac, et s’y noyèrent. Quelques uns parvinrent à gagner le parc à chevaux et à s’enfuir. D’autres se réfugièrent dans les collines avoisinantes. Lorsque le combat cessa, les Shawnees se mirent à l’œuvre avec leur couteau à scalper, pendant que d’autres rassemblaient le bétail, qui comprenait presque un millier de chevaux et de mules. Les hommes travaillaient vite, voulant en avoir fini avant que les Apache n’aient le temps de se regrouper et de contre-attaquer. On retrouva le guide Mexicain mort. SPYBUCK ordonna qu’il fût scalpé comme les autres. Quelques hommes protestèrent, mais SPYBUCK leur dit que, puisqu’il était mort, ses cheveux ne lui servaient plus à rien et son scalp pouvait passer pour celui d’un Apache et rapporter cent Pesos. Il était de notoriété publique que KIRKER n’était pas contre le fait de prendre, quand l’occasion s’en présentait, le scalp d’un Mexicain ou d’un Indien ami. En plus des scalps, des chevaux et des mules, la compagnie prit dix neuf femmes Apache en captivité, trois cent chèvres et brebis, et libéra une multitude de femmes et d’enfants Mexicains qui avaient été retenus prisonniers par les Apache. Quand les chasseurs de scalps revinrent en ville, Chihuahua City se mit en effervescence à force de fête. Le bruit avait précédé les hommes, et ils furent accueillis par un orchestre d’instruments à vent et des milliers d’admirateurs souriants. On présenta une mule chargée de cent quatre vingt deux scalps au gouverneur, lequel exultait et fit un discours vantant cette grande victoire sur la menace Apache. Après que l’on fît à nouveau prendre à la compagnie ses quartiers dans l’arène, KIRKER se rendit chez PORRAS et le gouverneur MONTERDE. PORRAS était content et s’acquitta de sa parole d’une manière satisfaisante, mais le gouverneur renia la promesse qu’il avait faite de payer. Il dit à KIRKER qu’il n’y avait malheureusement pas assez d’argent dans le trésor public pour couvrir les scalps. Les caisses ne contenaient qu’environ deux mille Pesos, soit un peu plus de dix pour cent que ce que le gouvernement devait. De plus, il y avait un problème avec le bétail, dont les anciens propriétaires demandaient que leurs animaux leur fussent restitués.
KIRKER lui rappela que leur contrat lui accordait la propriété de tout le bétail qu’il pouvait prendre au cours d’un raid, mais le gouverneur haussa tout simplement les épaules et dit qu’il n’y avait rien qu’il pût y faire. Lorsque KIRKER mit ses hommes en face de la tournure que les événements avaient pris, ils se mirent en colère jusqu’à la limite de la révolte. Ils traitèrent le gouverneur de traître pourri. SPYBUCK dit qu’il tuerait tout Mexicain qui ne ferait même que toucher l’un des animaux capturés. En réponse, MONTERDE appela l’armée. SPYBUCK et plusieurs autres de la compagnie s’apprêtèrent à se battre, s’estimant apparemment à armes égales à raison de cent chasseurs de têtes contre huit cent soldats Mexicains. Pourtant et avant qu’un coup de feu ne fût tiré, SPYBUCK se fraya un chemin à travers les rangs de l’armée Mexicaine et lança un ultimatum au gouverneur : « Tu lèves la mise ou tu meurs ! » Peut-être MONTERDE avait-il fait le même genre de pari. En tous cas, il s’inclina. SPYBUCK et les autres prirent leur part de butin dans le bétail et, prenant congé de KIRKER, quittèrent Chihuahua City pour Bent’s Fort. KIRKER resta au Mexique pendant quelque temps. Il accepta les deux mille Pesos du gouverneur et quitta la ville avec les quelques hommes qu’il lui restait, sentant qu’il avait été trahi par les Mexicains une fois de plus. Au regard de ce traitement, il est presque incompréhensible qu’à l’été de 1846, il chassait à nouveau les scalps pour le gouvernement du Chihuahua, cette fois sous l’administration de Angel TRIAS, lorsqu’il se rendit responsable des scalps que RUXTON avait vus décorer la cathédrale.
Il est difficile d’expliquer le désir répété de KIRKER de reprendre du service chez les Mexicains, après qu’ils l’eussent roulé tant de fois. Certains disent qu’il éprouvait une certaine loyauté pour sa patrie d’adoption, ce qui n’est pas croyable compte tenu de son implication du côté américain lors de la Guerre du Mexique. D’autres prétendent que sa famille, puisqu’il avait à cette époque cinq enfants avec sa femme Mexicaine, vivait toujours à Chihuahua, et qu’il se sentait concerné par leur bien-être. D’autres encore disent que la chasse aux scalps était la seule chose de rentable à faire dans la région, et que KIRKER n’avait jamais abandonné l’espoir de pouvoir un jour récupérer ce qu’on lui devait. N’importe comment, KIRKER avait à présent cinquante ans, un âge où la plupart des hommes de ce genre envisageaient sérieusement de laisser tomber leurs pertes et la vie violente. Mais KIRKER n’était pas vraiment prêt pour le rocking chair. Plus tôt la même année, le Président POLK avait déclaré la guerre au Mexique, et le gouverneur TRIAS, parfaitement conscient de ce que la défection de KIRKER signifierait pour Chihuahua, lui offrit au chasseur de scalps une place de colonel dans l’Armée Mexicaine. KIRKER répondit qu’il y réfléchirait. Au même moment, les Missouri Volunteers du colonel DONIPHAN venaient de capturer Santa Fe et marchaient vers le Sud. KIRKER ne réfléchit pas longtemps. Avec ses hommes, ils quittèrent le Mexique pour rejoindre les Missouriens de DONIPHAN, mais pas avant d’avoir soigneusement étudié les positions de l’Armée Mexicaine au Chihuahua. Peut-être KIRKER pensait-il soutirer en chair ce que les Mexicains lui devaient en argent. En tous cas, il fut éclaireur pour DONIPHAN et se battit à la bataille de Sacramento pour prendre Chihuahua City. KIRKER joua un rôle crucial dans cette bataille, menant cinq hommes à la charge en terrain ouvert contre un canon ennemi fortement défendu, et le détruisant en ne perdant qu’un seul homme. L’histoire démoralisa tellement les soldats Mexicains qu’elle offrit aux Américains une victoire facile. La part qu’avait joué KIRKER dans la défaite des Mexicains enragea tellement le Colonel TRIAS, que celui-ci offrit une prime de 10 000 $ pour la capture de l’ancien chasseur de scalps, mort ou vif. Cette prime resta valide jusqu’à la fin de la vie de KIRKER, qui ne revint jamais au Mexique. En 1847, KIRKER visita St. Louis et fut traité comme un héros de l’Ouest. Tous les journaux couvraient son arrivée. Une histoire dans l’un d’eux le créditait d’un total général de quatre cent quatre vingt sept Apache tués, pour la perte de seulement trois hommes. En automne, il retourna au Nouveau-Mexique où il géra un hôtel pendant quelque temps à Santa Fe. Mais la vieille vie de la chasse à l’Indien l’appelait, cette fois dans le Sud du Colorado, où il prit part à une campagne pour pacifier les Apache Jicarillas. En 1849, il conduisait une expédition à travers les plaines de Californie pour chercher de l’or. Un an plus tard, il vivait dans le Conté de Contra Costa, Californie, où il semble qu’il subvenait à ses besoins comme chasseur. Il y mourut à la fin de 1852 ou au début de 1853, de causes naturelles à ce que l’on dit.
Aujourd’hui, James KIRKER est aussi diffamé que loué, peut-être à juste titre. Mais en toute honnêteté, et sans défendre la chasse aux scalps et sa cruauté, il faut comprendre qu’il était le fruit de son temps et de l’endroit, et il ne peut donc être jugé qu’avec cet état de fait à l’esprit. Malgré tout ce qu’on a dit de lui, c’était un homme résolu, déterminé et courageux, et il combla un besoin qu’il n’avait pas créé lui-même. En tous cas, la chasse aux scalps culmina vers 1850, quand des hommes forgés par la Guerre du Mexique prirent la suite des affaires, et elle dura en quelque sorte jusque dans les années 1880. Les Apache ne furent pas défaits avant 1866, par le Général George CROOK. Mis à part quelques succès limités et éphémères, la chasse aux scalps ne fut jamais un moyen efficace pour régler le problème Apache. Elle ne fut jamais officiellement reconnue par le gouvernement Mexicain. Tous ses critiques prétendent qu’en plus d’être immorale et répréhensible, elle envenima la situation. Elle permit certainement de retourner les Apache contre les Anglos et à la fin, elle ne provoqua rien d’autre que de l’angoisse des deux côtés. Bref, ce fut une mesure désespérée, prise par des hommes désespérés à une époque désespérée.
Huit ans après le premier article, le même homme, sur lequel on a cherché depuis à en savoir plus, n’est donc plus présenté comme un vrai fumier. On essaye de le comprendre. C’est maintenant un homme de l’Ouest comme les autres, comme il y en eut tant. Bon d’accord, il a un peu massacré traîtreusement des Indiens pendant qu’ils dormaient ivres-mort, il en a sûrement tué dans le dos, mais ce n’étaient que des Indiens, et des mauvais en plus, de ceux qui massacrent les bons Blancs venant les envahir et qui leur volent leur bon whisky. Et puis, vendre un scalp de Mexicain pour un scalp d’Indien, ça fait quoi comme différence, au juste ? Un bon mexicon est un mexicon mort, la preuve c’est que les mexicons vont le rouler tout le temps. En plus, il reste à Chihuahua parce qu’il aime sa femme et ses cinq gosses, donc c’est un brave type. Mais il n’a toujours pas divorcé avec sa vraie femme, c’est-à-dire la seule légitime, celle qu’il a laissé à New-York en 1817. Faut dire qu’en dix ans, son ancienne bonne femme avait eu le temps de se faire une raison et comprendre qu’il ne reviendrait sûrement plus. Et puis on a presque pitié de lui, quand il se fait niquer sans arrêt par les mexicons. Faut pas déconner, on se crève le cul à courir après des Indiens, on se fait chier à les buter à coups de casse-tête ou en gaspillant de la bonne poudre et des bonnes balles, on se salit les pattes à découper leur cuir chevelu et à l’arracher, en risquant d’attraper des poux ou des maladies en plus, après ça on se salit les fringues, ça pue sous le soleil du désert mexicain le temps qu’on rentre, c’est plein de mouches qui viennent dessus, en plus faut les préparer ces scalps, faut les saler pour qu’ils pourrissent pas, et le sel ça brûle dans les coupures ou les blessures qu’on s’est faites aux mains en les scalpant, et en plus, quand on rentre enfin au bercail pour se saoûler la gueule, ces fainéants de mexicons qui passent leur temps à faire la sieste allongés sur le sol, un sombrero sur le neeeeez, en guise, en guise, en guise de parasol, ils trouvent le moyen de pas nous payer.